L'effraie de Philippe Jaccottet
"La nuit est une grande cité endormie
où le vent souffle...
Il est venu de loin jusqu'à l'asile de ce lit.
C'est la minuit de juin.
Tu dors, on m'a mené sur ces bords infinis,
le vent secoue le noisetier.
Vient cet appel
qui se rapproche et se retire, on jurerait
une lueur fuyant à travers bois, ou bien
les ombres qui tournoient, dit-on, dans les enfers.
(Cet appel dans la nuit d'été, combien de choses
j'en pourrais dire, et de tes yeux...)
Mais ce n'est que
l'oiseau nommé l'effraie, qui nous appelle au fond
de ces bois de banlieue.
Et déjà notre odeur
est celle de la pourriture au petit jour,
déjà sous notre peau si chaude perce l'os,
tandis que sombrent les étoiles au coin des rues.
Tu es ici, l'oiseau du vent tournoie, toi ma douceur, ma blessure, mon bien.
De vieilles tours de lumière se noient et la tendresse entrouvre ses chemins.
La terre est maintenant notre patrie.
Nous avançons entre l'herbe et les eaux, de ce lavoir où nos baisers scintillent à cet espace où foudroiera la faux.
« Où sommes-nous? »
Perdus dans le cœur de la paix.
Ici, plus rien ne parle que, sous notre peau, sous l'écorce et la boue,
avec sa force de taureau, le sang fuyant qui nous emmêle, et nous secoue comme ces cloches mûres sur les champs.
Comme je suis un étranger dans notre vie,
je ne parle qu'à toi avec d'étranges mots,
parce que tu seras peut-être ma patrie,
mon printemps, nid de paille et de pluie aux rameaux,
ma ruche d'eau qui tremble à la pointe du jour, ma naissante
Douceur-dans-la-nuit... (Mais c'est l'heure que les corps heureux s'enfouissent dans leur amour avec des cris de joie, et une fille pleure dans la cour froide.
Et toi?
Tu n'es pas dans la ville, tu ne marches pas à la rencontre des nuits, c'est l'heure où seul avec ces paroles faciles
je me souviens d'une bouche réelle...) ô fruits mûrs, source des chemins dorés, jardins de lierre, je ne parle qu'à toi, mon absent*, ma terre...
Je sais maintenant que je ne possè"de rien, pas même ce bel or qui est feuilles pourries, encore moins ces jours volant d'hier à demain à grands coups d'ailes vers une heureuse patrie.
Elle fut avec eux, l'émigrante fanée, la beauté faible, avec ses secrets décevants, vêtue de brume.
On l'aura sans doute emmenée ailleurs, par ces forêts pluvieuses.
Comme avant, je me retrouve au seuil d'un hiver irréel
où chante le bouvreuil obstiné, seul appel qui ne cesse pas, comme le lierre.
Mais qui peut dire
quel est son sens?
Je vois ma santé se réduire, pareille à ce feu bref au-devant du brouillard qu'un vent glacial avive, efface...
Il se fait tard.
Comme un homme qui se plairait dans la tristesse plutôt que de changer de ville ou bien d'errer, je m'entête à fouiller ces décombres, ces caisses, ces gravats sous lesquels le corps est enterré
que formèrent nos corps quand ils étaient serrés sur un lit de passage avec des cris de liesse. (C'est dans ce temps que notre ciel s'est éclairé, d'un astre sombre, et que j'eus bientôt mis en pièces...)
Ah! lâcher pour de bon ferraille, plâtre et planches!
Non, comme un chien je flaire un parfum répandu et gratte si profond qu'enfin j'aurai mon dû :
de tomber a mon tour en poussière bien blanche et de n'être plus rien qu'ossements vermoulus pour avoir trop cherché ce que j'avais perdu.
Sois tranquille, cela viendra!
Tu te rapproches, tu brûles!
Car le mot qui sera à la fin du poème, plus que le premier sera proche de ta mort, qui ne s'arrête pas en chemin.
Ne crois pas qu'elle aille s'endormir sous des branches ou reprendre souffle pendant que tu écris.
Même quand tu bois à la bouche qui étanche la pire soif, la douce bouche avec ses cris doux, même quand tu serres avec force le nœud de vos quatre bras pour être bien immobiles dans la brûlante obscurité de vos cheveux,
Elle vient,
Dieu sait par quels détours, vers vous deux, de très loin ou déjà tout près, mais sois tranquille, elle vient : d'un à l'autre mot tu es plus vieux."




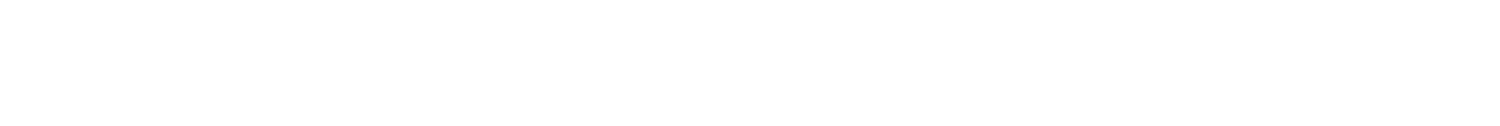


 .
.  (Verlaine)
(Verlaine) Stuart Merril !!
Stuart Merril !!

 , je m'en sers à l'envi (assez souvent en ce moment) je ne peux plus m'en passer, ça me détends énormément de recopier de jolis vers/prose dedans allongée sur mon lit avant de dormir, c'est vraiment un plaisir et puis j'attache une grande importance à retrouver des poèmes adorés (si je devais les rechercher sur mon ordinateur je n'aurais pas la même relation à la poésie), d'avoir un recueil de goûts personnels, je trouve ça assez triste que les gens quand on évoque la poésie n'aient en tête que celles des auteurs étudiés en classe
, je m'en sers à l'envi (assez souvent en ce moment) je ne peux plus m'en passer, ça me détends énormément de recopier de jolis vers/prose dedans allongée sur mon lit avant de dormir, c'est vraiment un plaisir et puis j'attache une grande importance à retrouver des poèmes adorés (si je devais les rechercher sur mon ordinateur je n'aurais pas la même relation à la poésie), d'avoir un recueil de goûts personnels, je trouve ça assez triste que les gens quand on évoque la poésie n'aient en tête que celles des auteurs étudiés en classe  et je ne sais pas vous mais ce n'est pas ceux que j'ai étudiés qui m'ont fait aimer la poésie ... Il faut sortir un peu des sentiers battus en poésie sinon on ne fait pas les belles rencontres littérairo-poétiques
et je ne sais pas vous mais ce n'est pas ceux que j'ai étudiés qui m'ont fait aimer la poésie ... Il faut sortir un peu des sentiers battus en poésie sinon on ne fait pas les belles rencontres littérairo-poétiques  tout ça pour dire que si tu as envie d'avoir ton carnet fonce
tout ça pour dire que si tu as envie d'avoir ton carnet fonce  c'est trop cool !
c'est trop cool ! ! ça sera avec plaisir quand j'aurais du temps
! ça sera avec plaisir quand j'aurais du temps toi aussi on a sûrement des goûts très concordants (ça risque d'être intéressant)
toi aussi on a sûrement des goûts très concordants (ça risque d'être intéressant)  je serais attentive à tous vos partages !!
je serais attentive à tous vos partages !!