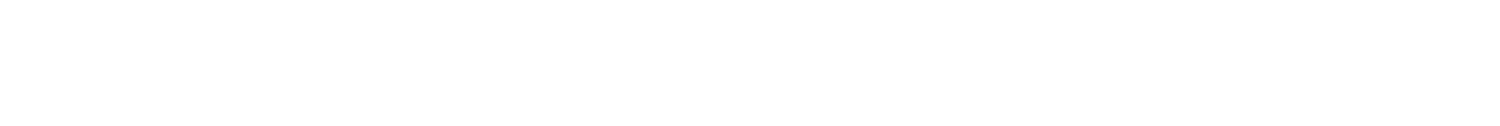Et toi, c'est quoi ton rêve ?
- Initiateur de la discussion Yana
- Date de début
Vous utilisez un navigateur obsolète. Il se peut que ce site ou d'autres sites Web ne s'affichent pas correctement.
Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
J'ai à peine trente ans et déjà une petite expérience de médecin militaire derrière moi, après avoir brillamment obtenu mon doctorat à Lyon. Je suis sur le terrain, dans tous les pays en guerre où la France s'insinue, et j'assure l'arrière des militaires blessés, des civils et des insurgés molestés. Depuis une semaine, quelques soldats et moi sommes dans un wagon ouvert du transsibérien traversant les steppes désertes. La peinture verdâtre de la tôle s'écaille. En son centre, l'étoile rouge effritée disparait sous des tags noirs datant de la chute de l'URSS. La Sibérie a un parfum de passé enfoui, de nostalgie violente, comme si toutes les âmes qui l'ont un jour composé et qui la compose étaient dispersées dans chaque petite maison, chaque pierre, chaque lac qui s'offrent à nos yeux. Nous avons froid et faim, mais l'excitation de la découverte nous exalte. Nous nous sentons l?étoffe d?expéditeurs découvrant une terre inconnue. A mesure que nous nous enfonçons vers le nord-est, le malaise s'intensifie: un étrange mélange de mélancolie et de gène s'empare de nous, et il me semble que ces forêts sombres et gigantesques cachent une vérité terrible, un passé maladroitement voilé par un présent inexistant. Comme si la Sibérie était fixée dans le temps, voguant dans les eaux troubles du passé, au son des cris des prisonniers.
Le malaise est violent, ce sont nos mensonges qui sont mis à nu, compactés en un violent trou noir, notre enfance qui semble baigner dans l'ombre l'oubli qui nous est renvoyé en plein visage. Le train s'arrête enfin. Nous mettons pied à terre parmi les vestiges d'habitations anciennes. Des barbelés, des planches et des plaques de tôle sont enfouis dans la neige, nous rappelant crument le sort des prisonniers du goulag.
(je sais pas ce que j'ai aujourd'hui j'ai l'impression d'être Louis Garrel)
Le malaise est violent, ce sont nos mensonges qui sont mis à nu, compactés en un violent trou noir, notre enfance qui semble baigner dans l'ombre l'oubli qui nous est renvoyé en plein visage. Le train s'arrête enfin. Nous mettons pied à terre parmi les vestiges d'habitations anciennes. Des barbelés, des planches et des plaques de tôle sont enfouis dans la neige, nous rappelant crument le sort des prisonniers du goulag.
(je sais pas ce que j'ai aujourd'hui j'ai l'impression d'être Louis Garrel)
A
Ancien membre
Guest
je reve d'avoir 3 enfants et une maison
je reve de m'edntendre mieux avec ma mere
je reve aussi d'ecrire un livre
je reve de m'edntendre mieux avec ma mere
je reve aussi d'ecrire un livre
Je rêve d'ouvrir ma librairie à Londres, et de finir mes jours avec lui, parce que dans mon rêve, il aurait changé.
Je rêve de faire carrière dans le domaine de la Mode
Je rêve d'exercer un métier qui ne me lasse pas
Je rêve d'ouvrir ma propre boutique vintage
Je rêve de trouver l'homme de ma vie
Je rêve que ce soit lui
Je rêve que ma famille soit à nouveau réunies
Je rêve d'avoir des enfants pour le voir
Je rêve d'un mariage rétro
Je rêve de pouvoir réaliser tous mes rêves
Je rêve d'exercer un métier qui ne me lasse pas
Je rêve d'ouvrir ma propre boutique vintage
Je rêve de trouver l'homme de ma vie
Je rêve que ce soit lui
Je rêve que ma famille soit à nouveau réunies
Je rêve d'avoir des enfants pour le voir
Je rêve d'un mariage rétro
Je rêve de pouvoir réaliser tous mes rêves
je reve de me marier
je reve d'avoir des enfants
je reve de rencontrer celui qui ne me decevra pas et qui m'aimera autant que je l'aimerais
je reve d'ecrire un livre
je reve d'ouvrir un restaurant
je reve d'avoir des enfants
je reve de rencontrer celui qui ne me decevra pas et qui m'aimera autant que je l'aimerais
je reve d'ecrire un livre
je reve d'ouvrir un restaurant
A
Ancien membre
Guest
Je rêve de pouvoir avoir tout les instruments de musique existant dans le monde et pouvoir tous les essayer !
Je rêve d'une énorme bibliothèque dans mon salon, remplie de livres, de disques, de films qui m'ont marqués. Ce serait ma bibliothèque pleine de passion.
Je rêve de termines mes études sans trop de mal et de réussir à économiser assez pour partir en voyage le plus tôt possible. Je rêve de vivre dans différents pays, nommer toutes mes destinations de rêve, c'est trop long. Je veux partir pendant 4 à 6 mois, ou plus, on verra. Voyager, vivre et sourire.
Je rêve d'avoir assez de budget pour faire tous les piercings et les tatouages que je veux. Tous ces projets qui sont présents depuis des années, comme si je sens que je me sentirai plus ''complète'' avec ces parcelles de moi encrées à jamais. Je retrouve mes anciens piercing de plus en plus, cet anneau de nouveau présent n'est qu'un début.
Je rêve de nouveau à des rêves que j'avais rangés, mais qui en fait sont plus présents que jamais dans mon coeur maintenant .
.
Je rêve de termines mes études sans trop de mal et de réussir à économiser assez pour partir en voyage le plus tôt possible. Je rêve de vivre dans différents pays, nommer toutes mes destinations de rêve, c'est trop long. Je veux partir pendant 4 à 6 mois, ou plus, on verra. Voyager, vivre et sourire.
Je rêve d'avoir assez de budget pour faire tous les piercings et les tatouages que je veux. Tous ces projets qui sont présents depuis des années, comme si je sens que je me sentirai plus ''complète'' avec ces parcelles de moi encrées à jamais. Je retrouve mes anciens piercing de plus en plus, cet anneau de nouveau présent n'est qu'un début.
Je rêve de nouveau à des rêves que j'avais rangés, mais qui en fait sont plus présents que jamais dans mon coeur maintenant
 .
.Discussions similaires
- Réponses
- 3 K
- Affichages
- 352 K
- Réponses
- 2
- Affichages
- 7 K
- Réponses
- 12
- Affichages
- 2 K
- Réponses
- 45
- Affichages
- 26 K
- Réponses
- 24
- Affichages
- 24 K
M
Les Immanquables du forum
Participe au magazine !
Une info qu'on devrait traiter sur madmoiZelle ?
Nouvelle ou perdue ?
Pas de panique, on t'aime déjà !
La charte de respect du forum
Le guide technique &
le guide culturel du forum
Viens te présenter !
Un problème technique ?
Topic d'entraide sur l'orthographe et la grammaire
La chefferie vous informe
Les annonces de l'équipe concernant le forum et madmoiZelle
Rendre visite à madmoiZelle
Le médiateur du forum
Soutiens madmoiZelle financièrement
Topic dédié à la pub sur mad
Si vous aimez madmoiZelle, désactivez AdBlock !
Les immanquables
Les topics de blabla
En ce moment... !
Mode - Beauté - Ciné - Musique - Séries - Littérature - Jeux Vidéo - Etudes - Ecriture - Cuisine - People - Télévision
Envie de rencontrer des MadZ ?
Viens trouver le forum de ta ville !
Mode
Le pire de la mode
Ces vêtements qui te font envie
Ta tenue du jour
La tenue qui plaît
Tes derniers achats de fringues
Beauté
Astuces,bons plans économies & dupes
Le topic des vernis
Questions beauté en tout genre
Culture
Le meilleur des images du net
L'aide aux devoirs
Tu écoutes quoi ?
Quelle est ta série du moment ?
Quel livre lisez-vous en ce moment ?
Le dernier film que vous avez vu à la maison
Le topic philosophique
Société
Topic des gens qui cherchent du travail
Voyager seule : conseils et témoignages
Trucs nuls de la vie d'adulte : CAF, Banque, Mutuelle, Logement etc...
Les topics universels
Je ne supporte pas
Je ne comprends pas
Ca me perturbe
Je me demande
J'adore...
Je m'en veux de penser ça mais...
Cupidon
Le topic des amoureuses
Le topic des polyamoureuses
Les Célibattantes
Une info qu'on devrait traiter sur madmoiZelle ?
Nouvelle ou perdue ?
Pas de panique, on t'aime déjà !
La charte de respect du forum
Le guide technique &
le guide culturel du forum
Viens te présenter !
Un problème technique ?
Topic d'entraide sur l'orthographe et la grammaire
La chefferie vous informe
Les annonces de l'équipe concernant le forum et madmoiZelle
Rendre visite à madmoiZelle
Le médiateur du forum
Soutiens madmoiZelle financièrement
Topic dédié à la pub sur mad
Si vous aimez madmoiZelle, désactivez AdBlock !
Les immanquables
Les topics de blabla
En ce moment... !
Mode - Beauté - Ciné - Musique - Séries - Littérature - Jeux Vidéo - Etudes - Ecriture - Cuisine - People - Télévision
Envie de rencontrer des MadZ ?
Viens trouver le forum de ta ville !
Mode
Le pire de la mode
Ces vêtements qui te font envie
Ta tenue du jour
La tenue qui plaît
Tes derniers achats de fringues
Beauté
Astuces,bons plans économies & dupes
Le topic des vernis
Questions beauté en tout genre
Culture
Le meilleur des images du net
L'aide aux devoirs
Tu écoutes quoi ?
Quelle est ta série du moment ?
Quel livre lisez-vous en ce moment ?
Le dernier film que vous avez vu à la maison
Le topic philosophique
Société
Topic des gens qui cherchent du travail
Voyager seule : conseils et témoignages
Trucs nuls de la vie d'adulte : CAF, Banque, Mutuelle, Logement etc...
Les topics universels
Je ne supporte pas
Je ne comprends pas
Ca me perturbe
Je me demande
J'adore...
Je m'en veux de penser ça mais...
Cupidon
Le topic des amoureuses
Le topic des polyamoureuses
Les Célibattantes